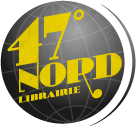Forum Latitude : Anatomie de la violence
Forum Latitude #3 : Anatomie de la violence - 19, 20 et 21 novembre à Motoco
Â
En 2017, à rebours des idées reçues, le professeur de psychologie américain Steven Pinker théorisait dans son livre « La part d’ange en nous », un déclin de la violence dans nos sociétés contemporaines. Jamais, dans l’Histoire, une époque aurait été à ce point paisible pour l’espèce humaine.
D’autres, en revanche, responsables politiques, intellectuels ou personnalités médiatiques, jurent que notre société connaîtrait depuis quelques années un niveau de violence inégalée. 

Aux uns qui prétendent que les faits de violences sont plus nombreux, les autres rétorqueront qu’ils sont simplement plus exposés. Toujours est-il que, loin de s’en tenir à un débat chiffré sur l’insécurité réelle ou fantasmée, ou de se limiter aux affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, aux agressions physiques, racistes, homophobes, antisémites, aux attentats terroristes ou aux incivilités, les violences qui fragmentent nos sociétés apparaissent de plus en plus omniprésentes dans le débat public. 

Si la violence est un mot fourre-tout qui peut désigner aussi bien une bousculade dans une cour de récréation qu’un crime contre l’humanité, la guerre, la violence d’état, la criminalité, la violence domestique et la violence verbale composent un ensemble avec lequel nous sommes forcés de cohabiter au quotidien et qu’il nous apparaît essentiel d’interroger pour en comprendre non seulement la nature, mais surtout pour en mesurer l’ampleur réelle et esquisser des pistes de réflexion pour s’en détourner.
Pour sa troisième édition du Forum Latitude, et alors que s’ouvre une campagne présidentielle où la brutalité des idées, du verbe et de la confrontation risque de s’inviter aux premières loges, la librairie 47°Nord tentera de vous offrir un espace de discussion et de partage permettant de faire l’anatomie de la violence et de réfléchir ensemble à quelques-unes des problématiques que pose celle-ci à notre présent, pour mieux envisager le futur.
Ce Forum, qui se tiendra les 19, 20 et 21 novembre à Motoco, a pour ambition de réunir les acteurs et actrices de la vie intellectuelle et culturelle impliqués par les questions qui le composeront. La pluralité des opinions doit permettre de confronter les points de vue dans une démarche bienveillante et constructive, avec pour objectif d’ouvrir des pistes de réflexion et dresser un état des lieux et un panorama non exhaustif - car tant d’autres sujets pourraient être abordés - de la violence dans notre quotidien. Le tout afin de porter une réflexion croisée sur l’état du monde en 2021 : la société est-elle ou non plus violente qu’avant ?
Au final, ce sont 21 conférences-débats qui se tiendront sur trois jours avec une quarantaine d'intervenants, des philosophes, sociologues, écrivains, historiens, scientifiques, artistes, responsables politiques, journalistes ou militants associatifs.
Nous vous proposons de découvrir ici le programme de ces trois journées, lors desquelles vous pourrez également profiter d'un espace bar/restauration en continu.
Les nombreux frais engagés à cette occasion nous contraignent, de manière exceptionnelle et alors que nous faisons toujours le nécessaire pour assurer la gratuité de nos événements, à rendre payant l’accès à celui-ci et, se faisant, à compter sur votre compréhension et votre précieux soutien. Les billets seront ainsi mis en vente via l’adresse suivante, 10€ par jour le samedi et le dimanche, 5€ le vendredi ou 15€ les trois jours, avec la gratuité maintenue pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les personnes en situation de handicap et les moins de 18 ans (sur justificatif)
https://www.billetweb.fr/forum-latitude-anatomie-de-la-violence
Vous pourrez également acheter votre billet sur place le jour de l’événement.
La programmation est susceptible d'être modifiée jusqu'au dernier moment, pour des imprévus indépendants de notre volonté. Aucun remboursement ne sera possible. Nous vous remercions de votre compréhension.


D'autres surprises devraient néanmoins s'ajouter encore à la programmation d'ici à la manifestation.
L’événement sera accessible sur présentation ou non du pass sanitaire en fonction des décisions gouvernementales qui seront entérinées le 15 novembre. Le port du masque reste obligatoire dans le bâtiment.
Nous pouvons compter sur le précieux soutien de nos partenaires, que nous remercions ici chaleureusement : Motoco, le groupe Barrisol, la Ville de Mulhouse, la Maison - Mulhouse Centre, le Service Universitaire d'Action Culturelle (SUAC) de l'Université de Haute Alsace, le Coff'Tea Shop Tilvist, le Cinéma Bel Air, le Château d’Orschwihr - Vins d’Alsace, et le groupe BioCoop
Â
Â
VENDREDI 19 NOVEMBRE
Salle 1
20h : LA PRISE DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE PASSE-T-ELLE PAR LA CATASTROPHE ?
Le réchauffement climatique met aujourd’hui l’humanité face au plus grand défi de son Histoire. En heurtant le mur climatique, la société de consommation de l’ère pétrolière génère des effets dévastateurs qu’il n’est plus possible d’ignorer, collectivement et individuellement. Au-delà des politiques dont il faut attendre une réaction à la hauteur des enjeux, c’est à chacun d’entre nous que la question du changement d’attitude est posée.
Que disons-nous de nos responsabilités ?
Que faisons-nous concrètement ?
Que sommes-nous prêts à céder de nos modes de vie et dans quelle condition ?
Sommes-nous vraiment prêts au changement ou seul le surgissement de la catastrophe est-il en mesure de provoquer la prise de conscience ?Â
Intervenants : Dominique BOURG - François GEMENNE
animation : Brice MARTIN
Â
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Salle 1
11h : LA VIANDE EST-ELLE UN MEURTRE ?
De plus en plus d’individus (militants ou non) considèrent l’élevage, le commerce et la consommation de viande comme un meurtre, voire un assassinat. Les antispécistes s’opposent quant à eux à toute hiérarchie entre espèces, notamment humains et animaux, certains d’entre eux n’hésitant pas à recourir à des actions violentes pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme un « zoocide ».
De nombreux intellectuels et écrivains, Isaac Bashevis Singer, John Maxwell Coetzee, Marguerite Yourcenar ou Vassili Grossman comparent même la situation des animaux à la Shoah.
Alors, dérapage sémantique ou aveuglement et omerta qui perdurent ? Doit-on considérer l’industrie de la viande comme un « génocide animalier » ?
La souffrance infligée aux animaux est-elle l’un des derniers tabous que les sociétés humaines doivent lever vers un monde véritablement égalitaire ?
Intervenants : Thomas LEPELTIER - Frédéric PAULIN
animation : Anne SALETES
12h30Â : LA VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS
Pédocriminalité, sévices, coups, inceste, infanticides, violences éducatives ordinaires etc. Le phénomène de maltraitance contre les enfants a toujours existé, enseveli sous l’omerta. Entre confusion, silence banalisé, protection institutionnalisée des bourreaux, déni ou flou statistique, les histoires tragiques s’enchaînent tandis que l’opinion publique et la société restent figées dans le malaise face à des récits qui leur semblent insupportables. Les témoignages par le livre, pourtant, se multiplient, toujours plus bouleversants.
Comment s’en saisir pour libérer la parole, l’écoute, et vaincre ce fléau ?
Intervenantes : Camille KOUCHNER - Catherine ROBERT
animation : Antoine JARRY
14h : LE FOOTBALL DOIT-IL RÉGLER TOUS LES PROBLÈMES DE LA SOCIÉTÉ ?
« Les footballeurs doivent montrer une frontière claire entre le bien et le mal » déclarait en 2010 Rama Yade, alors Secrétaire d’État au Sport. Pour Chantal Jouanno, sa successeure, « les footballeurs sont des stars. Or, les stars définissent les valeurs de notre société ».
N’est-ce pas là beaucoup demander, dans la répartition des responsabilités, à des sportifs dont on moque par ailleurs régulièrement les attitudes, les discours ou les affaires de moeurs ?
Les injonctions à l’exemplarité s’étendent désormais à la contagion émotionnelle des tribunes perçue comme irrémédiablement raciste ou homophobe. Les supporters parleront eux d’une violence contre-culturelle, d’un folklore impénétrable pour les béotiens, et d’une réaction face à l’emprise de l’argent et de la culture de masse sur une passion sacrificielle.
Alors, le stade est-il vraiment un espace autonome où les propos prononcés, grossiers et insultants, n'ont aucun avenir transgressif ? Confier le soin aux footballeurs d’être des exemples pour la société n’est-il pas un aveu d’échec des institutions de la République ?
Intervenants : Vincent DULUC - Marie PORTOLANO Â
animation : Paul DIDIER
15h30Â : VIOLENCE PARTOUT, JUSTICE NULLE PARTÂ ?
La fraternité peut-elle être considérée comme un délit ?
Poursuivi par la Justice pour son aide humanitaire apportée à des migrants venus d’Italie, Cédric Herrou a été définitivement relaxé en 2021. Mais cet interminable épisode judiciaire est le symbole d’un rapport de plus en plus conflictuel entretenu par la Justice et les citoyens face aux faits de violence, sous toutes les formes. La médiatisation de certains procès et la multiplication de polémiques et de faits-divers encouragés par les réseaux sociaux et les chaînes d’information en continu entretiennent l’idée d’une « justice à deux vitesses » qui épargnerait les uns et serait impitoyable avec les autres.
Pourtant pilier fondamental de nos démocraties, la Justice est-elle suffisamment armée pour répondre aux réalités de la société contemporaine, ne pas échouer dans sa mission et pousser le citoyen à se tourner vers la vengeance pour pallier ses défaillances ?
Intervenants : Gilles FAVAREL-GARRIGUES - Marion GACHET-DIEUZEIDE - Laurent GAYER - Cédric HERROU
animation : Jean-Marie VALDER
17h : MOURIR POUR UN DESSIN
Janvier 2015 a placé la caricature et le dessin de presse au coeur de tous les débats. L’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020 a ravivé tristesse, colère et incompréhension. Avec « Charlie Hebdo », soutenu par une majorité de Français, vilipendé dans certains pays musulmans, la caricature a été réaffirmée comme bastion avancé de la liberté d'expression et de la laïcité.
Pourtant, de nouvelles attaques sont venues la remettre en cause ces cinq dernières années : même le New York Times a décidé, en 2019, de cesser d'en publier pour échapper aux polémiques. Quant à son rapport avec les religions en général et l’islam en particulier, il ne cesse de se détériorer, de nombreux musulmans se sentant directement insultés par les dessins satiriques destinés à moquer leur religion.
Alors pourquoi un tel raidissement actuel sur le fait religieux et sur les valeurs républicaines ? Et comment distinguer l'intention humoristique de la propagande haineuse, voire raciste ?
Intervenants : Xavier GORCE - Richard MALKAÂ
animation : Pascal DIDIER
Â
Salle 2
11h30 : LE FÉMINISME PEUT-IL FAIRE L’ÉCONOMIE DE LA RADICALITÉ
Les procès en « radicalité » voire en « misandrie » contre le féminisme se multiplient ces derniers mois, dans le sillage d’un mouvement qui semble se diviser en différents courants : féminisme décolonial, féminisme universel, intersectionnalité etc. Pour les uns, certaines femmes développeraient un féminisme universaliste qui refuserait de voir disparaître l’ancien monde de domination masculine.
Pour les autres, celles que l’on nomme grossièrement les « néo-féministes » refuseraient quant à elles de réduire le féminisme à l’égalité des droits et des chances alors que les femmes continuent de subir des violences physiques, morales et sexuelles.Quitte à bousculer sérieusement le débat public dans leurs revendications et leurs modes d’action.
Intervenantes : Tristane BANON - Martine STORTI
animation : Pascal DIDIER
13h : DÉFINIR LA VIOLENCE
Au sens le plus courant, la violence renvoie à des comportements et des actions physiques, consistant dans l’emploi de la force contre un individu avec les dommages physiques que cela implique. Mais la « violence » est loin d’être un concept univoque et répond à certaines normes. Elle n’est pas du tout la même si l’on pense à la guerre comme activité technique organisée, aux violences associées aux traumatismes psychiques, ou encore liées à des situations de travail dans lesquelles on subit des pressions. Parfois intentionnelle et manifeste, elle sera, dans d’autres situations, subie par ceux-là mêmes qui la commettent.
Alors de quoi y a-t-il expression quand nous parlons de « violence » ? Quels sont les sens et les acceptions du terme  et comment l’appréhender ?
Intervenants : Michaël FOESSEL - Gérard HADDAD
animation : Jonathan DAUDEY
14h30Â : MOTS QUI ENFERMENT, MOTS QUI TUENT
« Il y a des mots aussi meurtriers qu'une chambre à gaz » écrit Simone de Beauvoir pour expliquer son refus de soutenir le recours en grâce de Brasillach, condamné à mort et exécuté en 1945. Peut-on tout dire ? Et à quel prix ?
D’autant que la simplification du langage de plus en plus importante, alimentée par des réseaux sociaux où l’expression est limitée, favorise et encourage l’usage d’insultes, d’anathèmes et le cloisonnement binaire de la pensée du contradicteur. Lorsqu’il s’agit de s’adresser sereinement et explicitement à un interlocuteur, avec lequel on ne partage pas la même appartenance, les mêmes convictions ou les mêmes croyances, un vocabulaire exsangue ne donne aucune chance de relever le défi d’une explication sereine.
Quelles sont alors les conséquences réelles sur le vivre-ensemble de l’usage de ces mots qui, souvent, enferment et réduisent à néant la contradiction ?
Intervenants : Fabrice HUMBERT - Gisèle SAPIRO
animation : Antoine JARRY
16h : L’ÉCRIVAIN FACE À LA VIOLENCE DU MONDE
"Le rôle de l’écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. (…) Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’Histoire : il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d’hommes, ne l’enlèveront pas à la solitude, même et surtout s’il consent à prendre leur pas.
Mais le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du Monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil, chaque fois du moins, qu’il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence, et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l’Art".Â
Discours de réception du Prix Nobel par Albert Camus, 1957 Regards croisés sur la noirceur du monde et la capacité de la littérature et des écrivains à s’en saisir pour mieux l’éclairer.
Intervenants : Laure GOURAIGE - Fabrice HUMBERT - Laurent MAUVIGNIER - Frédéric PAULIN
animation : Antoine JARRY
17h30 : COMMENT DES HOMMES ORDINAIRES DEVIENNENT DES « MONSTRES »
Assassinats, terrorisme, infanticides … Pourquoi les actes les plus barbares sont-ils si souvent commis par les hommes les plus ordinaires ?
Un mari, une mère, un voisin respectable, un jeune homme discret. Ni déterminisme social ni trouble psychiatrique ne sauraient valablement tout expliquer. Il faut, au contraire, traiter des raisons individuelles qui conduisent progressivement à devenir déraisonnable. Quels sont alors les mécanismes psychiques à l'oeuvre pour que leur pensée se vide et que plus rien ne les retienne ?
Quelles barrières émotionnelles et morales sont un temps franchies pour que surgisse l'impensable ?
Intervenants : Roland GORI - Gilles KEPEL - Daniel ZAGURY
animation : Francis STOFFEL
Â
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Â
Salle 1
11h : FAUT-IL CRAINDRE LA CANCEL CULTURE ?
Déboulonnage de statues, livres renommés, oeuvres réinterprétées à la lumière de la modernité, artistes boycottés etc. La « cancel culture » propose d'effacer purement et simplement du paysage des personnalités soupçonnées d'avoir fauté.
Pour les uns, il s’agit d’une pratique vertueuse, signe d’une prise de conscience face aux systèmes d’oppressions ancestraux.
Pour les autres, elle est une nouvelle forme d'ordre moral, une dérive extrême consistant à investir l’espace public pour qu’il se fasse à la fois arbitre et bourreau.
La « cancel culture » signe-t-elle l’assignation à résidence identitaire, le confinement de la pensée et la destruction de la nuance et des zones grises ?
Ou au contraire, est-elle une sédition salvatrice destinée avant tout à traiter les problèmes de pouvoirs, à rééquilibrer les forces et à valoriser les victimes des systèmes d’oppression ?
Intervenants : Olivier BEAUD - Anne-Laure BUFFET - Xavier GORCE - Gisèle SAPIRO
animation : Bernard JACQUÉ
13h : COMMENT SORTIR DES VIOLENCES POLICIÈRES ?
Des voix de plus en plus nombreuses de la société française expriment leur indignation voire leur consternation devant la recrudescence des violences policières. D’autres considèrent que l’expression elle-même, subodorant une dérive systémique plutôt que des écarts individuels, est impropre.
Comment en est-on arrivé là ? Alors que notre pays s’enorgueillissait d’être exemplaire en matière de maintien de l’ordre, il se retrouve en queue de peloton des pays européens.
D’où l’urgence de reprendre cette histoire récente et se demander comment sortir de ce fléau qui fait monter la pression sociale, menace le droit de manifester, salit l’institution policière et abîme l’image de notre pays.
Intervenants : David DUFRESNE - Christophe KORELLÂ
animation : Anne SALETES
Cette discussion sera suivie à 17h d'une projection du film de David Dufresne "Un pays qui se tient sage", en sa compagnie, au Cinéma Bel-Air, 31 rue Fénélon à Mulhouse.
14h30 : LE DÉCLIN DE LA FRANCE EST-IL INÉVITABLE ?
Quand le général de Gaulle a pris le pouvoir en 1958, la France était quasiment par terre. En consacrant une biographie à cette figure française tutélaire derrière laquelle courent aveuglément tous les responsables politiques contemporains, Franz-Olivier Giesbert interroge ce qu’il estime être le déclin, en quelques décennies, de notre pays, dans un mélange de déni, de masochisme et de contentement de soi. Ainsi, et tirant les leçons d'une résurrection française qui, sur le moment, semblait impossible, il décrit la violence d’un déclin économique, culturel et social, mais rappelle aussi que rien n’est jamais écrit à l’avance.
Intervenant : Franz-Olivier GIESBERT
animation : Antoine JARRY
16h : LES VIOLENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES SONT-ELLES LA MATRICE DE TOUTES LES AUTRES ?
Il est d’usage, bien souvent et à juste titre, de se scandaliser de la violence physique, sexuelle et matérielle, visible et spectaculaire, qui blesse, handicape ou tue, tout en minimisant l’impact des inégalités économiques et des injustices sociales dans l’émergence des crimes et délits et les dégâts considérables qu’elles provoquent chez les individus et au coeur des sociétés.
Doit-on alors considérer la violence comme naturellement consubstantielle non seulement à l’humanité mais aussi la vie ou doit-on parler de matrices de violences invisibles qui entraîneraient toutes les autres ?
Intervenants : Arno BERTINA - Ludivine BANTIGNY - François BOULO
animation : Renaud MELTZ
17h30 : SANS LA LIBERTÉ
L’esprit du temps a changé : alors que les Français sont égaux et jouissent en principe d’une liberté de conscience, il s’installe un désintérêt croissant des citoyens face à la disparition insidieuse de l’Etat de droit. Entre manifestations réprimées des gilets jaunes et « loi Avia » contre les contenus haineux sur Internet, les mesures d’exception instaurant des systèmes répressifs dans le but de réprimer des menaces se banalisent dans une entreprise sécuritaire à laquelle semble adhérer une majorité de Français.
Mais l’aspiration à la sécurité est-elle véritablement incompatible avec le principe de liberté ?
Faut-il nécessairement privilégier l’une au détriment de l’autre ?
Intervenant : François SUREAU
animation : Antoine JARRY
Salle 2
11h30Â : LE SENS DE LA GAUCHE
La gauche française traverse une crise multidimensionnelle, peinant à réaliser l’union électorale et fracturée par des dissensions profondes quant aux valeurs même qu’elle est supposée défendre en 2021. Cette division est symptomatique d’une agora politique soumise à des oppositions et des affrontements de plus en plus clivés et violents. Justice sociale, égalité, laïcité, autant de concepts supposés rassembler ceux qui s’en veulent les défenseurs, et pourtant, ce sont plus que jamais « deux gauches irréconciliables qui semblent cohabiter, s’accusant tantôt de faire le jeu de l’islam politique, tantôt de la droite nationaliste.
Comment expliquer ce paradoxe, symbole d’oppositions politiques de plus en plus brutales ?
Intervenants : Jean-Yves CAMUS - Amine EL KHATMI - Joseph SPIEGEL
animation : Paul DIDIER
13h30 : LE GOÛT DES FAITS-DIVERS
Que nous racontent les faits divers ?
Pourquoi certains crimes nous marquent-ils plus que d’autres ? De l’affaire Grégory au feuilleton Dupont de Ligonnès, de Jonathann Daval au tueur du Zodiac, sans oublier l’incontournable Jack l’Éventreur, l’opinion publique, la presse, la télévision, le cinéma et désormais les séries télévisées se passionnent pour ces drames humains, devenus le miroir des travers et des tourments de la condition humaine, suscitant autant la fascination que la répulsion.
Comment expliquer cet attachement morbide et cet intérêt souvent honteux ?
Intervenants : Laurence LACOUR - Thierry MOSER
animation : Jean-Marie VALDER
15h : VIOLENCE CONTRE LES FEMMES : FAIRE FACE
Le terme est désormais aussi fréquent dans les médias et parmi les politiques que les drames se succèdent : un féminicide est commis tous les deux jours et demi en moyenne en France. Désignant le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, il n’est pas entré dans le droit, mais son usage familier rappelle que nous cohabitons quotidiennement avec des violences sexistes, qu’il s’agisse de la forme la plus extrême de ces violences ou d’autres, moins connues ou médiatisées, comme les violences économiques (pressions financières par le conjoint, inégalités salariales etc.) ou la construction d’une société indexée au confort quotidien des hommes.
Et si les violences faites aux femmes sont un fléau planétaire qui n’épargne aucune société, force est de constater que certains pays se donnent plus les moyens que d’autres de tenter d’y mettre fin.Â
Comment lutter, à l’échelle individuelle comme à l’échelle collective, contre les violences conjugales et sexistes, comment s’en protéger, et comment permettre une meilleure prise en charge des victimes et favoriser leur écoute ?
Intervenantes : Laure GOURAIGE - Marie PORTOLANO - Emanouela TODOROVA
animation : Anne SALETES
16h30 : COVID-19 ET DÉTRESSES PSYCHOLOGIQUES
La pandémie vécue depuis un an et demi n’a pas fini de faire des dégâts. Confinement, déconfinement, couvre-feu, port du masque, la pandémie a profondément troublé la population. Anxiété, solitude, décompensations… Au-delà de la maladie elle-même avec laquelle nous apprenons à composer, la santé psychique d’adultes, mais aussi de nombreux enfants, s’est fortement dégradée. A cela s’ajoutent les failles d’un système qui sombrait dans l’inhumanité lorsqu’il s’est agit d’interdire aux familles l’adieu à leurs proches disparus.
Comment gérer les conséquences psychologiques de cette crise inédite et quels enseignements peut-elle nous apporter à l’avenir ?
Intervenante : Stéphanie BATAILLE
animation : Jean-Marie VALDER
Â
PORTRAIT DES INTERVENANTS :
Tristane BANON : Journaliste, Tristane Banon a collaboré avec différents journaux (« Paris Match », « Le Figaro » et « Atlantico ») ainsi qu’à des émissions sur France Inter (« Les affranchis », « Microfictions ») ou dans « Ça balance à Paris » (Paris Première), mais se révèle également en tant que romancière, publiant notamment « Noir délire », « J’ai oublié de la tuer » ou « Prendre un papa par la main ».
Ludivine BANTIGNY : Ludivine Bantigny est historienne, maîtresse de conférences à l'université de Rouen. Elle travaille sur l'histoire des mouvements sociaux et des engagements politiques. Parmi ses publications figurent l'ouvrage de référence "1968, de grands soirs en petits matins".
Stéphanie BATAILLE : Comédienne et metteuse en scène (notamment d’Alex Vizorek) passée par la Comédie-Française, directrice déléguée du Théâtre Antoine depuis 2011, membre du jury de l’émission télévisée « On n’demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier en 2014, Stéphanie Bataille s’élève depuis plusieurs mois contre l’inhumanité du système hospitalier suite à la disparition de son père, le comédien Etienne Draber, des suites de la Covid-19.
Olivier BEAUD : Juriste et universitaire, Olivier Beaud est l’auteur de plusieurs ouvrages ainsi que d’un grand nombre d’articles portant sur la théorie générale de l’État, la pensée juridique et le droit constitutionnel, il mène des réflexions sur la notion de liberté académique et enquête sur les menaces qui la visent, résultant de la lutte contre le terrorisme, de l'utilisation abusive d'internet, ou encore de la promotion des revendications identitaires.
Arno BERTINA : Écrivain, auteur de nombreux romans et récits, dont une fiction autobiographique consacrée à Johnny Cash, Arno Bertina s'exprime fréquemment en faveur de l'accueil des réfugiés d'Afrique ou du Moyen-Orient, et participe activement à la vie de quelques associations, dont L'Atelier Zinzolin (Malakoff) et A.S.I. (Congo-Brazzaville)
François BOULOÂ : François Boulo est avocat au barreau de Rouen. En tant que porte-parole des Gilets jaunes, il a défendu leurs revendications devant les médias. Il poursuit aujourd'hui son engagement en apportant sa pierre à l'édifice de l'émancipation politique.
Dominique BOURG : Philosophe et professeur honoraire à l’université de Lausanne, Dominique Bourg est spécialiste des questions environnementales, notamment sur les sujets d’éthique et de développement durable, président jusqu’en 2018 du conseil scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot pour la Nature et l’Homme.
Anne-Laure BUFFET : Anne-Laure Buffet est thérapeute, conférencière et formatrice spécialisée dans l'accompagnement de personnes victimes de violences psychologiques, fondatrice de l’association Contre les violences psychologiques. Elle est l'auteure de plusieurs livres consacrés à ces thématiques, parmi lesquels « Mères qui blessent » et « Les prisons familiales ».
Jean-Yves CAMUS : Jean-Yves Camus dirige depuis 2014 l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et est chercheur associé à l’IRIS. Il est le plus éminent spécialiste français de l’extrême-droite et s’intéresse également aux groupes radicaux islamistes. En novembre 2015, il publie avec Nicolas Lebourg l’ouvrage de référence sur « Les Droites extrêmes en Europe ».
David DUFRESNE : Journaliste passé par le milieu rock et de nombreux médias (« Best », « Libération », « I-Télé », « Médiapart »), David Dufresne s’intéresse très jeune aux questions liées à la police et aux libertés publiques. Auteur de plusieurs livres, il réalise également de nombreux documentaires parmi lesquels « Un pays qui se tient sage », sorti au cinéma en 2020 et nommé aux Césars dans la catégorie « meilleur documentaire ».
Vincent DULUC : Journaliste sportif et romancier, Vincent Duluc rejoint le quotidien « L’Équipe » dès 1995 dont il est aujourd’hui la plume la plus célèbre. Il participe également à de nombreuses émissions de débats sur le football parmi lesquelles « On refait le match » ou « L’Équipe du soir ». Il publie plusieurs romans très personnels articulés autour du football (dont un portrait de George Best) ou du cinéma (« Carole et Clark »). Depuis octobre 2021, il est président de l’Union des Journalistes de Sport de France (UJSF).
Amine EL KHATMI : Conseiller municipal et communautaire à Avignon de 2014 à 2020 et longtemps membre du Parti Socialiste, Amine El Khatmi est président du Printemps républicain depuis 2017. Fondée en mars 2016, l'association regroupe des intellectuels, des élus et des citoyens qui entendent défendre la laïcité, la nation et l'universalisme.
Gilles FAVAREL-GARRIGUESÂ : Gilles Favarel-Garrigues est directeur de recherches aux CNRS. Il travaille sur les questions de déviance, de police et de justice à partir d'enquêtes menées principalement en Russie.
Michaël FOESSEL : Philosophe spécialisé sur le sens et les risques de l'expérience démocratique et sur le cosmopolitisme, Michaël Foessel publie notamment en 2019 un remarqué « Récidive », ouvrage dans lequel il fait une analyse comparative de la situation contemporaine de la France avec celle de 1938, considérant que l’État de droit est similairement affaibli.
Marion GACHET-DIEUZEIDEÂ : Après des études de lettres puis de management, Marion Gachet-Dieuzeide vit différentes expériences associatives en France et à l'étranger. En 2017, elle fait un voyage de 4 mois en Europe à la rencontre des personnes et associations venant en aide aux personnes exilées. Sur sa route elle croise Cédric Herrou qu'elle décide de rejoindre dans la Roya pour l'aider au camp, à l'animation de communauté, la communication, les partenariats, et la gestion de projets.
Laurent GAYERÂ : Laurent Gayer est chargé de recherche au CNRS. Spécialiste du sous-continent indien, il s'intéresse plus particulièrement aux dynamiques urbaines et aux mobilisations violentes en Inde et au Pakistan.
François GEMENNE : François Gemenne enseigne les politiques du climat et des migrations dans différentes universités, notamment à Sciences Po et à Bruxelles. Chercheur du FNRS à l'Université de Liège, il y dirige l'Observatoire Hugo, un centre de recherche sur l'environnement et les migrations.
Franz-Olivier GIESBERT : Figure médiatique bien connu, romancier primé (Grand prix du roman de l'Académie française en 1992, Prix Interallié en 1995), essayiste et biographe, notamment de de François Mitterrand et de Jacques Chirac, Franz-Olivier Giesbert a dirigé "Le Nouvel Observateur", "Le Figaro" et "Le Point", où il continue d'être éditorialiste, et a été Directeur éditorial de "La Provence".
Xavier GORCE : Xavier Gorce est dessinateur de presse indépendant depuis 1986, rendu célèbre par ses fameux « Indégivrables », des manchots qui traitent au quotidien de l’actualité, d’abord publiés sur lemonde.fr, qu'il a quitté en janvier 2021 suite à un dessin polémique, et désormais dans « Le Point ».
Roland GORI : Psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à Aix-Marseille-Université, Roland Gori est l’initiateur, en décembre 2008, de l’Appel des Appels qui invitait les professionnels du soin, de la justice, de l'enseignement ou de la culture à se rassembler, échanger pour réagir et s'opposer aux logiques de normalisation et d'évaluation dans ces domaines.
Laure GOURAIGE : Diplômée de philosophie, Laure Gouraige a soutenu un mémoire sur le philosophe et théologien anglais du moyen-âge Guillaume d’Ockham. Elle compose en outre des textes pour La Galerie du spectacle, un « magazine du théâtre et du livre ». En 2020, elle publie un remarquable premier roman sur l’emprise et la violence par l’exigence, « La Fille du père ».
Gérard HADDAD : Ingénieur agronome, mais aussi médecin psychiatre, psychanalyste, essayiste et traducteur (hébreu), il est notamment l’auteur de l’un des rares témoignages relatant une psychanalyse avec Jacques Lacan (« Le jour où Lacan m’a adopté » (2002).
Cédric HERROU : Agriculteur originaire de la région niçoise, Cédric Herrou commence, en 2016, à venir en aide à des milliers d'exilés franchissant la frontière franco-italienne, à quelques kilomètres de chez lui, transformant sa ferme en un lieu d'accueil et d'accès à la demande d'asile. Son combat, largement médiatisé, lui a valu quantité d'arrestations et de procès, redonnant une actualité à la question du « délit de solidarité ». Il a créé en juillet 2019 la communauté Emmaüs Roya, première communauté paysanne du mouvement Emmaüs.
Fabrice HUMBERT : S’il enseigne la littérature, Fabrice Humbert est surtout connu pour ses romans parmi lesquels une trilogie autour de la violence, conclue en 2012 avec « Avant la chute » mais dont le titre majeur reste « L’origine de la violence » (2009), un livre à caractère autofictionnel qui raconte l'histoire d'un professeur de lycée qui visite le camp de concentration de Buchenwald avec ses élèves et croit reconnaître son père dans la photo d'un détenu, et qui fut couronné de nombreux prix et adapté au cinéma par Elie Chouraqui.
Gilles KEPEL : Gilles Kepel, professeur à l'université Paris Sciences et Lettres, dirige la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'Ecole normale supérieure et s’est imposé comme l’un des spécialistes reconnus à l’international de l’islam politique. Il est également professore aggregato à l'Université de la Suisse italienne, et enseigne à Sciences Po (Paris et Menton).
Christophe KORELL : Christophe Korell est entré dans la police en 1996 et a rejoint, fin 2009, le groupe « Enquêtes Générales » chargé des affaires de criminalité organisée, traitant principalement les enquêtes liées aux bijouteries (vols, braquages). Après vingt ans de "maison", dont quinze de police judiciaire, il est désormais détaché au ministère de la Justice et préside l'association Agora des citoyens, de la police et de la justice.
Camille KOUCHNER : Avocate et maître de conférences en droit privé, Camille Kouchner publie en janvier 2021 son premier livre, « La Familia Grande », consacré à l’inceste et à l’emprise, ainsi qu’à l’omerta qui entoure très souvent ces crimes, se confiant sur son histoire personnelle et les abus sexuels dont son frère jumeau fut victime par leur beau-père durant leur adolescence.
Laurence LACOUR : Correspondante d’Europe 1 dans l’Est de la France en 1984, Laurence Lacour a couvert « l’affaire Grégory » au jour le jour. Hantée par ce qu’elle a vu, elle quitte son métier et décide d’écrire « Le bûcher des innocents », une enquête longue de dix ans et devenue le livre incontournable sur l’affaire autant que sur le métier de journaliste. Considérée comme une référence en matière de déontologie, elle enseigne ainsi depuis 1993 l’éthique dans les écoles de journalisme, de police, de gendarmerie, de magistrats, et même à l’ENA.
Thomas LEPELTIER : S’inscrivant dans la pensée antispéciste, Thomas Lepeltier, docteur en astrophysique, est un essayiste spécialisé en histoire et philosophie des sciences ainsi qu'en éthique animale.
Richard MALKA : Avocat, Richard Malka est intervenu dans de nombreux procès et débats de société emblématiques de l’époque, en lien avec la liberté d’expression, le droit au blasphème et la laïcité. Il assure notamment la défense de l’hebdomadaire satirique « Charlie Hebdo » ou de la jeune adolescente Mila. Il est l’auteur de plusieurs livres consacrés aux combats qu’il mène depuis de nombreuses années, mais également romancier et scénariste de bandes dessinées.
Laurent MAUVIGNIER : Romancier, il se prend de passion pour l’écriture alors qu’il est hospitalisé à l’âge de huit ans. En recevant un exemplaire de « Un bon petit diable » de la Comtesse de Ségur, il mesure combien il est possible d’échapper au réel en s’identifiant à un personnage en mouvement alors qu’on est soi-même immobilisé. Il travaille depuis à l’élaboration d’une Å“uvre dont le roman est le pivot, signant quelques-uns des romans contemporains les plus remarquables, mais qui cherche aussi vers le cinéma et le théâtre, et dans laquelle la question de la violence a une importance toute particulière.
Thierry MOSER : Maître Thierry Moser, avocat, a exercé durant toute sa carrière à Mulhouse, sa ville natale. Spécialisé en droit pénal, il est intervenu dès 1985 et jusqu'à ce jour pour les époux Christine et Jean-Marie Villemin et a occupé comme partie civile dans différents procès qui ont retenu l'attention du public dont les procédures dirigées contre Pierre Bodein, Michel Fourniret et Francis Heaulme.
Frédéric PAULIN : Frédéric Paulin écrit des romans noirs depuis presque dix ans. Il utilise la récente Histoire comme une matière première dont le travail peut faire surgir des vérités parfois cachées ou falsifiées par le discours officiel. Ses héros sont bien souvent plus corrompus ou faillibles que les mauvais garçons qu'ils sont censés neutraliser, mais ils ne sont que les témoins d'un monde où les frontières ne seront jamais plus parfaitement lisibles.
Marie PORTOLANO : Journaliste et présentatrice de télévision, Marie Portolano participe de 2014 à 2018 au « Canal Football Club » sur Canal + avant de prendre les rênes de l’émission « Canal Sports Club » jusqu’à mars 2021. À la même période, son documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » fait sensation en brisant le tabou du sexisme dans le journalisme sportif. Elle anime, depuis la rentrée 2021, « Le meilleur pâtissier » sur M6.
Catherine ROBERT : Catherine Robert est professeure de lettres et de théâtre. Elle a écrit des textes mêlant pièces classiques et créations originales, ainsi que deux contes musicaux (« L'Enfant et la Terre à mystères » et « Rouge-Gorge »), étudiés dans plusieurs conservatoires de musique. Au printemps 2021, elle publie son premier roman, « La Caresse du loup », un conte noir pour les adultes qui veulent croire en leur revanche.
Gisèle SAPIRO : Gisèle Sapiro est directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de l'engagement des intellectuels, des rapports entre littérature et politique, et de la circulation internationale des oeuvres et des idées. Ses travaux s’inscrivent dans la continuité de l’oeuvre de Pierre Bourdieu, prenant la direction du dictionnaire international consacré au sociologue (600 notices et 126 contributeurs) et publié fin 2020.
Joseph SPIEGELÂ : Ancien professeur de sport et champion régional de 800 mètres, Jo Spiegel a été maire de Kingersheim (Haut-Rhin) de 1989 à 2020, et président de la communauté d'agglomération de Mulhouse. Il a été conseiller régional (1986 - 1998) et conseiller général (1988 - 2008). Sa commune est devenue un laboratoire réputé de démocratie participative.
Martine STORTI : Martine Storti est journaliste (passée notamment par « Libération »), militante féministe et ancienne inspectrice générale de l'Education nationale. Elle questionne autant ce qui se donne pour des radicalités (intersectionnalité, décolonialité, afro-féminisme), que l'instrumentalisation du féminisme dans une perspective identitaire, nationaliste et raciste.
François SUREAU : François Sureau est haut-fonctionnaire, avocat et écrivain. Auteur de nombreux romans, essais et recueils de poèmes et de nouvelles, il s'est engagé depuis plusieurs années pour la défense des libertés publiques et contre l’état d’urgence. En octobre 2020, il est élu à l’Académie Française au fauteuil de Max Gallo.
Emanouela TODOROVA : Emanouela Todorova milite activement pour l'égalité des genres et la place de la femme dans la société. Le 10 juillet 2020, après avoir été une nouvelle fois victime de harcèlement de rue, elle crée le compte Instagram @disbonjoursalepute sur lequel elle recense les témoignages de victimes de propos sexistes et de harcèlement de rue, donnant alors la parole aux victimes.
Daniel ZAGURY : Daniel Zagury est psychiatre des hôpitaux français, spécialiste de psychopathologie et de psychiatrie légale, également chef de service et expert auprès de la Cour d’appel de Paris. Son expertise est mondialement reconnue et il fut ainsi appelé à témoigner dans de multiples procès pour d’importantes affaires criminelles (Guy Georges, Michel Fourniret, Patrice Alègre, les génocidaires rwandais, l’affaire Sarah Halimi etc.).