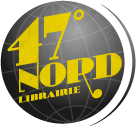Forum Latitude 2023 - Portrait des intervenants

PORTRAIT DES INTERVENANTS :
Â
Arié ALIMIÂ : Avocat au barreau de Paris depuis 2001, Arié Alimi fonde son cabinet spécialisé en droit immobilier commercial mais il développe rapidement une autre clientièle sur les questions des libertés publiques.

Il se spécialise alors dans les affaires de violences policières, et assure notamment la défense de Jean-Luc Mélenchon, de la famille de Rémi Fraisse, d’une vingtaine de gilets jaunes ou encore de la famille de Cédric Chouviat, mort en 2020 suite à l’interpellation de policiers à Paris en 2020.
Lors du mouvement social contre le projet de réforme des retraites en France de 2023, il est saisi par une dizaine de gardés à vue, dont les arrestations ont essentiellement eu lieu dans des « nasses », technique jugée illégale par le Conseil d'État en « l'absence de conditions précises ».
Aline ALZETTA-TATONEÂ : Aline Alzetta-Tatone est psychosexologue et thérapeute de couple. Spécialiste de la communauté trans, elle se forme en prise en charge des personnes trans à la Sorbonne de Paris.
Cofondatrice et présidente du Collectif Sui Generis pour la visibilité trans et Cofondatrice du Refuge-Neuchâtel, elle milite depuis quelques années à la reconnaissance des droits des personnes trans et leur visibilité dans la sphère publique.
Dans son livre « Transidentités - les clés pour comprendre » qu’elle veut inclusif, clair et sans sensationnalisme, elle nous guide dans la découverte de ce qu’est la trans identité pour les adultes : les obstacles rencontrés lors du parcours de transition (psychologique, médical, administratif, social, familial), l’importance des réseaux de soutien et les enjeux rencontrés au quotidien.
Adrien BIASSIN : Docteur, chercheur, enseignant, conférencier, auteur, éco-aventurier, Adrien Biassin est diplômé de SKEMA Business School, diplômé de l’ENA, docteur en histoire contemporaine orientation économie de l’Université de Strasbourg et de l’Université de Haute-Alsace.
En 2019, il a soutenu devant Pablo Servigne et Dominique Bourg la première thèse de doctorat en France sur les risques d’effondrement à l’échelle des territoires.
Ses thématiques de recherche concernent les risques d’effondrement, la résilience des territoires et plus particulièrement les politiques de transition avec une réflexion sur les processus individuels et collectifs.
Fabien BOUGLÉ : Initialement consultant en gestion de patrimoines artistiques (il dirige notamment un département "oeuvres d'art" d'une banque française puis rejoint AXA Art), Fabien Bouglé se spécialise par la suite dans la politique énergétique.

Depuis de nombreuses années, il dénonce ainsi ce qu’il présente comme le désastre écologique et financier des éoliennes, publiant notamment le livre « Éoliennes, la face noire de la transition écologique ».
Plus récemment, il s’attaque au « Nucléaire : les vérités cachées » qui vise à mettre en lumière les vertus de cette source d’électricité sans occulter la question des déchets radioactifs.
Fabien Bouglé est, par ailleurs, conseiller municipal de la ville de Versailles.
Régis BOULAT : Régis Boulat est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Haute-Alsace et est notamment un spécialiste de Jean Fourastié, célèbre économiste à l’origine de l’expression « les Trente Glorieuses » à qui il a consacré sa thèse de fin d’études.
Il se spécialise plus largement sur les sujets de modernisation de la France ou de désindustrialisation en Alsace.

Il publie notamment, en 2021, « L’intelligence collective depuis 1826 » consacré à l’histoire de la Société Industrielle de Mulhouse (SIM) puis un autre, deux ans plus tard », à l’École de Chimie.

Avec Renaud Meltz, il publie également en 2021 une biographie de l’ancien ministre de l’Intérieur et maire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement.
Dominique BOURG : Philosophe spécialiste des questions environnementales, directeur de la revue « La Pensée écologique », Dominique Bourg est professeur honoraire à l’université de Lausanne où il enseigne les sciences de l'environnement.
Il a participé à l'élaboration de la Charte de l’environnement de 2005 et a présidé le conseil de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’Homme jusqu'en 2018.
Ses derniers livres témoignent une fois encore de son engagement à agir pour la cause environnementale : avec « Au coeur des années affreuses, sales et méchantes » (PUF, septembre 2023) il distille ses commentaires et réflexions sur l'actualité entre 2019 et 2023, de l'assassinat de Samuel Paty à l'invasion de l'Ukraine, en passant par l'assaut du Capitole à Washington en 2021.
Un journal éco-philosophique pour mieux cerner les contours d'une société écologique, que Dominique Bourg estime impensable en dehors d'une bascule de civilisation.
Vincent BRENGARTH : Vincent Brengarth est avocat au Barreau de Paris. Il traite de dossiers touchant aux libertés fondamentales (défense des victimes de violences policières, de personnes poursuivies pour « délit de solidarité »…).
Il intervient également aux côtés de William Bourdon dans la défense de lanceurs d’alerte mais aussi dans des dossiers internationaux, assistant par exemple l’association SHERPA dans plusieurs procédures anti-corruption (affaire Rifaat Al-Assad, affaire dite du « financement libyen »…)
Il écrit par ailleurs régulièrement des articles juridiques et des tribunes (pour « Le Monde », « Libération », « Politis », le « Huffington » …) et est l’auteur, avec le journaliste Jérôme Hourdeaux, du livre « Revendiquons le droit à la désobéissance » puis, avec son confrère William Bourdon, du tract Gallimard « Violences policières ».
Benjamin BRICE : Diplômé de l’ESSEC et docteur en sciences politiques de l’EHESS, Benjamin Brice est essayiste, auteur en 2022 de « La sobriété gagnante. Pouvoir d’achat, écologie, déficits : Comment sortir de l’impasse ? » puis, en 2023, de « L’impasse de la compétitivité » dans lequel il dénonce le coût important des politiques de compétitivité entraînant, selon sa démonstration, un sous-financement des services publics qui mine la cohésion du pays et accélère son déclassement.Â
Â
Antoine BUÉNO : Antoine Buéno est écrivain, chargé de mission au Sénat et chargé d'enseignement à Sciences Po.
Auteur de quatre romans, il écrit aussi pour le théâtre. Au Sénat, il suit les questions sociales, européennes et culturelles pour le groupe des sénateurs centristes.
Maître de conférence à l'IEP de Paris, il dispense un cours d'écriture créative axé sur le thème de l’utopie et se spécialise également sur la question de la prospective, de l’environnement et des nouvelles technologies.
Il a également collaboré avec différents médias parmi lesquels Paris Première, LCI, France Inter, Europe 1, France Info, ou dans l’émission « 28 Minutes » sur Arte.
Il publie ces jours « Faut-il une dictature verte ? » dans lequel il plaide pour une autre écologie, qu’il veut aux antipodes de « l'écologisme idéologique qui domine le débat public ».
Anne-Claude CRÉMIEUX : Anne-Claude Crémieux est l'une des infectiologues les plus sollicitées par les médias depuis l'émergence du Covid-19 et l'une des 50 Françaises les plus influentes de 2020 selon « Vanity Fair ».
Membre correspondant de l'Académie nationale de médecine et membre de l'Académie des technologies, elle est professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis-Université Paris Cité.
Dans les années 1990, elle a dirigé le centre de dépistage du sida et des infections transmissibles à l’hôpital Bichat-Claude-Bernard. Le 21 avril 2023, elle est nommée par décret du président de la République au collège de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Laure DAUSSY : Après être passée par le site de décryptage médias « Arrêt sur Images » (2010 à 2014), « La nouvelle édition » sur Canal + ou « 28 Minutes » sur Arte, Laure Daussy, journaliste d’investigation, devient reporter à Charlie Hebdo. 
Elle y fait son entrée en tant que pigiste quelques semaines seulement après les attentats de janvier 2015, avant d’être intégrée dans la rédaction en juillet 2019.
Spécialisée sur les questions de société, de laïcité, de féminisme, de liberté d’expression, elle effectue aussi des grands reportages à l’étranger, consacré par exemple aux athées en Tunisie ou au mouvement pour l’IVG en Pologne.
Inscrite dans une ligne proche du féminisme universaliste, elle publie en cette rentrée « La réputation, enquête sur la fabrique des « filles faciles » », enquête d’un an à Creil, sur l’histoire de Shaïna Hansye, et au-delà, sur les violences vécues par les adolescentes à Creil et dans les quartiers populaires.
Patrice DEBRÉ : Médecin immunologiste, diplômé de la Harvard Medical School, Patrice Debré a pour domaines d'expertise l'immunologie, l'immunopathologie, l'immunogénétique, le cancer, le sida et les greffes. Professeur d'immunologie à l'université Pierre-et-Marie-Curie et membre de l'Académie nationale de médecine, il a été chef de service et directeur d'un institut de recherche en immunologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et, depuis 2010, ambassadeur de France chargé de la lutte contre le sida et les MST.

En 2022, il dresse le portrait de Louis Pasteur dans « Une journée particulière du Professeur Pasteur » après avoir, deux ans plus tôt, publié « La recherche en temps d’épidémie » dans lequel il retrace notamment l’évolution de la recherche contre l’épidémie de sida dont il reste une figure majeure à travers le monde.
Hélène DEVYNCK : Hélène Devynck est journaliste de télévision. 
Elle participe notamment à la création de la première chaîne française d’information en continu LCI en 1994, sur laquelle elle présente les journaux dans l’émission de Michel Field ainsi que les journaux du soir, puis les tranches de l’après-midi jusqu’en 2009.

En 2019, elle adapte, avec Emmanuel Carrère, le livre « Le quai de Ouistreham » de Florence Aubenas, devenu le film « Ouistreham » inteprété notamment par Juliette Binoche.
Le 8 novembre 2021, elle fait partie des sept femmes témoignant à visage découvert dans les colonnes de « Libération », sur des faits de viol, d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel qu’elles disent avoir subi de la part de Patrick Poivre d’Arvor. Elle écrit, à la rentrée 2022, « Impunité », un livre bouleversant sur ces événements et leurs conséquences.
Henri ECKERT : Henri Eckert est professeur émérite de sociologie à l’Université de Poitiers, spécialisé dans les questions d'insertion professionnelle des jeunes et d'insertion sociale.
Il travaille également sur les jeunes ouvriers et la socialisation ouvrière, les classes populaires, la discrimination à l’école et sur le marché du travail, la massification et/ou la démocratisation de l’école, ou encore la sociologie de l’éducation, de la jeunesse et des professions.
Dans son livre « La communauté disloquée », il tente de rendre compte de l'étrange comportement électoral des habitants de la Haute vallée de la Thur qui votent de plus en plus massivement pour la candidate lepéniste aux élections présidentielles, alors qu'ils continuent de voter pour les partis de centre droit, d'inspiration chrétienne-sociale, aux élections locales, liant ce comportement paradoxal aux bouleversements sociaux induits par l'effondrement de l'activité industrielle qui avait assuré la prospérité de la vallée depuis la fin du XVIIIe siècle jusque dans les années 1970.
Samuel FITOUSSI : Économiste de formation, passé par Cambridge et HEC Paris, Samuel Fitoussi est l'auteur de billets d'opinion et de chroniques dans la presse, collaboré avec le journal « Contrepoints » puis, depuis 2021, avec « Le Figaro Vox ».
Également contributeur pour la « Revue des Deux Mondes » et sur BFM TV, il écrit également des courts-métrage (Les séducteurs), des nouvelles de fiction ou des satires sur l’actualité, couvrant tout particulièrement des sujets de société comme l’éducation, les moeurs ou la religion.
Cinéphile averti, il publie en cette rentrée 2023 « Woke Fiction », dans lequel il dénonce la réécriture de la fiction et les contraintes sur la liberté artistique par le mouvement woke et tout ce qui n'est pas en ligne avec une vision ultra-politisée du monde et de la culture.
Jean-Baptiste FORRAY : Journaliste et rédacteur en chef délégué de « La Gazette des Communes », Jean-Baptiste Forray est l'auteur de grandes enquêtes marquantes dont « Les barons, ces élus qui osent tout » et « La République des apparatchiks ».
Dans « Au coeur du grand déclassement » paru en 2022, enquête journalistique et plongée littéraire donnant la parole aux oubliés et dans laquelle il analyse le déclassement d'une France jugée désormais dépassée, à travers la destinée de Peugeot-Sochaux et de son club de football, vendu en 2015 à des propriétaires chinois.
Il raconte la gloire évanouie des générations de patrons, d'ouvriers, de footballeurs, de supporters qui, entre labeur et ferveur, ont hissé haut le drapeau des automobiles Peugeot. Jusqu'à ce que l'usine, le stade, le quartier se réduisent comme peau de chagrin.
Le récit mélancolique d'un monde disparu, le constat implacable des ravages des délocalisations, la saga vibrante des perdants de la mondialisation.
Jean GARRIGUES : Historien et universitaire, spécialiste d’histoire politique, professeur émérite à l’université d’Orléans, Jean Garrigues le Comité d’histoire parlementaire et politique, soutenu par l’Assemblée Nationale et le Sénat, depuis 2002.
Ses recherches portent sur la vie politique en France du milieu du xixe siècle à nos jours, les relations entre pouvoir économique et pouvoir politique, les centres, les libéraux, la vie parlementaire, les contre-pouvoirs et les groupes de pression.
Il est par ailleurs l'un des intervenants réguliers de l'émission de télévision « C dans l’air" diffusée sur France 5, et apparaît également dans « 24 heures en questions » sur LCI ou dans « On Va Plus Loin » sur Public Sénat. 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels, en 2022, « Élysée contre Matignon » consacré aux relations tantôt fructueuses, tantôt tumultueuses entre les Présidents de la République et leurs Premiers ministres.

Raphaël GLUCKSMANNÂ : Fils du philosophe André Glucksman, Raphaël Glucksmann est essayiste et, depuis quelques années, responsable politique.
Il s’engage très tôt dans les révolutions démocratiques géorgienne et ukrainienne. Dès 2004, il réalise ainsi avec David Hazan le documentaire « Orange 2004 » sur la révolution orange en Ukraine puis devient conseiller du président géorgien Mikheil Saakachvili de 2008 à 2013.
Il signe en 2018 « Les Enfants du vide. Sortons de l’individualisme », un essai appelant les générations d’après Mai 68 à inventer de nouveaux liens sociaux, à créer un horizon collectif pour sortir de l’individualisme sans renier l’héritage de 1968.
La même année, il participe à la fondation du mouvement Place Publique aux côtés, notamment, de Jo Spiegel. Sous cette étiquette, il est élu député européen en 2019, mandat lors duquel il est élu président de la Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, et contribue à une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux concernant le génocide des Ouïghours.
Hervé LE BRAS : Le plus célèbre des démographes français, également historien et chercheur à l’Institut National d’Études Démographiques (INED). Hervé Le Bras est une figure familière du grand public, connue pour prendre régulièrement position sur des sujets de société ou touchant à la démographie dans différents médias.
Il publie par exemple en 2022 « Il n’y a pas de grand remplacement » en réaction aux thèses de Renaud Camus et de l’extrême-droite, la qualifiant de « dangereux mensonge qui masque et déforme les problèmes parfois graves posés par l’immigration au détriment de réponses sérieuses ».
Également enseignant, il donne des cours tout au long de sa vie dans différentes structures, comme l’École nationale des Beaux-Arts, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ou encore Sciences-Po Paris.
Il publie en cette rentrée 2023 « La réforme des retraites expliquée … au gouvernement » dans lequel il dresse le constat sans complaisance des errements qui ont conduit, selon lui, à une réforme inefficace et injuste.
Jérôme LEFILLIÂTRE : Journaliste originaire du Cotentin, Jérôme Lefilliâtre est grand reporter à « Libération » où il est notamment en charge des questions d’économie et des médias.
Il a grandi dans une région qui n’a jamais cessé de débattre des dangers et des avantages du nucléaire.
Auteur de « Mister K. - Petites et grandes affaires de Daniel Kretinsky », il publie surtout au printemps 2023 « Les Falaises de Flamanville », son premier roman faisant revivre les grandes heures de la contestation anti-nucléaire, vertigineux sur les questions écologiques déjà toutes posées au début des années 1970.
Raphaël LIOGIER : Raphaël Liogier est sociologue et philosophe. Professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, il y enseigne la sociologie et l’anthropologie et y dirige depuis 2006 l'Observatoire du religieux. Il est également diplômé en philosophie de l'université d'Edimbourg et de l'université de Provence et il enseigne à Paris au Collège international de philosophie.
Ses travaux portent depuis une vingtaine d'années sur les croyances, au-delà du simple cadre religieux et de leurs formes dans l'imaginaire contemporain, des groupes new age au bouddhisme occidentalisé, des biotechnologies au désir d'immortalité des transhumanistes, en passant par la peur de l’islamisation.
Dans son essai de 2016, « Sans emploi : condition de l'homme postindustriel », il participe aux réflexions autour de la mise en place d’un revenu universel qu'il considère comme salutaire.
Dans « Khaos », publié en cette rentrée, il souhaite démontrer que ce n’est pas tant la modernité, que d’aucuns n’ont de cesse de décrier, qui est la cause de nos divers effondrements (environnementaux, sociaux, psychiques ou civilisationnels) mais la trahison de sa promesse initiale.
Georges MALBRUNOT : Georges Malbrunot a été grand reporter au « Figaro », en tant que correspondant à Jérusalem, et est devenu un spécialiste du Moyen-Orient, plus particulièrement du conflit israélo-palestinien.
Au début des années 2000, il commencera à écrire des ouvrages en marge de son travail de journaliste, et en 2003, il s’installe à Bagdad, peu de temps après le renversement de Saddam Hussein.
L’année suivante, il sera enlevé, avec son confrère et co-auteur de nombreux ouvrages Christian Chesnot par l’Armée islamique qui demande l’abrogation de la loi française sur les signes religieux dans les établissements publics en échange de leur libération. Ils sont finalement libérés le 21 décembre 2004, après 124 jours de détention.
De cet enlèvement, ils tireront tous deux un ouvrage qu’ils publieront, en 2005, « Mémoires d’otages : notre contre-enquête ».
Après sa libération, Georges Malbrunot retourne s’installer en France, où il continuera à Å“uvrer comme journaliste pour « Le Figaro ». Il continuera aussi à publier régulièrement des ouvrages, co-écrits pour la plupart, notamment sur l’entrisme qatari.
Éric MARTY : Éric Marty est écrivain, essayiste, professeur de littérature contemporaine. Son premier engagement est politique puisqu’il milite, au début des années 1970, dans l’organisation trotskiste Lutte ouvrière.
Après avoir enseigné la littérature française, la linguistique et la philosophie à Londres, il intègre le CNRS en 1988 comme chargé de recherche dans le laboratoire de l’Institut des textes et manuscrits modernes, avant de poursuivre une longue carrière universitaire. Sa rencontre en 1976 avec Roland Barthes, dont il deviendra l’un des plus proches amis, a été décisive pour son orientation intellectuelle ; il la raconte dans la première partie de son « Roland Barthes, le métier d’écrire », paru aux éditions du Seuil en 2006.
Il est, depuis, l’éditeur des Å“uvres complètes de Roland Barthes.
Écrivain, il est auteur d'un roman, « Sacrifice » (1992), et écrit également des poèmes et des nouvelles publiées dans la revue « L’Infini », ainsi que des pièces radiophoniques diffusées sur France Culture.
Dans « Le Sexe des Modernes, Pensée du Neutre et théorie du genre », en 2021, Éric Marty revient sur la période des années 60, « pendant laquelle la question sexuelle devient une question collective et sociale : les magazines ne cessent de parler de sexualité, masculine ou féminine.
Hugo MICHERON : Hugo Micheron est enseignant-chercheur en sciences politiques, sociologie et géopolitique, éminent spécialiste de la radicalisation islamique et des relations entre la France et le Moyen-Orient. Il obtient en 2019 un doctorat en sciences politiques pour sa thèse réalisée à l’École normale supérieure sous la direction de Gilles Kepel, intitulée "Quartiers, prisons, Syrie-Irak, comment se structure et s’organise le jihadisme en France ?".
Dans le cadre de ses travaux, il interroge environ 80 jihadistes détenus en France après avoir participé à la guerre civile syrienne sous le drapeau de l’État islamique en Irak et au Levant, condamnés ou non.
Sa thèse de doctorat donne lieu à la publication en 2020 d’un ouvrage qui fait désormais référence et intitulé « Le Jihadisme français. Quartiers, Syrie, prisons ».

En 2023, il est récompensé par le Prix du livre géopolitique pour « La colère et l’oubli - les démocraties face au jihadisme européen ».
Karim MISKÉ : Karim Miské est écrivain et réalisateur de films documentaires. Depuis son premier film « Économie de la débrouille à Nouakchott » réalisé en 1988 avec Brigitte Delpech, il observe les mutations du monde, à travers des thèmes comme les rapports Nord-Sud et Orient-Occident (« Islamisme, le nouvel ennemi » en 1995, « Sur la route des Croisades » en 1996, « Contes Cruels de la Guerre », réalisé avec Ibéa Atondi en 2002) mais aussi la surdité (« La parole des sourds » en 2000) ou encore la bioéthique (« Un choix pour la vie » en 2009).
En 2013, il réalise un documentaire remarqué en 4 épisodes, « Juifs et Musulmans, si loins, si proches » et en 2020, « Décolonisations », tous deux diffusés sur Arte.
En 2012, il publie « Arab Jazz », un premier roman très remarqué et multi-récompensé, notamment par le grand prix de littérature policière, puis en août dernier « La situation », roman d’anticipation plongeant dans la noirceur d’un pays fracturé.
Marwan MOHAMMED : Sociologue, chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) puis au CNRS, Marwan Mohammed oriente ses recherches vers les comportements délinquants, les espaces de l’illicite en France et aux États-Unis, les jeunesses populaires ou encore sur le racisme et les inégalités.
Auteur de nombreux articles sur ces sujets, il a également publié de nombreux ouvrages remarqués parmi lesquels « Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le ‘’problème musulman’’ » en 2013.

En cette rentrée 2023, il publie « Y a embrouille - sociologie des rivalités de quartier », une enquête sur une culture de « l’embrouille » permettant aux jeunes d’exprimer leur loyauté, leur identité sociale et une quête de respectabilité dans un contexte d’échec : « Je m’embrouille donc je suis. »
François MOLINS : L’une des figures les plus respectées de l’institution judiciaire française.
François Molins, procureur de la République de Paris de 2011 à 2018, fut le visage emblématique et rassurant pour des milliers de Français tandis que leur pays était frappé par les vagues d’attentats terroristes à partir de 2012.
Après plus de 46 ans de service, le plus haut magistrat du parquet en France prend sa retraite en juin 2023, mais il restera dans la mémoire collective le visage familier de l’antiterrorisme, apparaissant chaque soir sur les écrans de télévision pour adoucir les peurs paniques et le sentiment d’impuissance qui émergeaient dans le sillage des cavales sanguinaires des frères Kouachi ou de Salah Abdeslam.

Il termine sa longue carrière, de 2018 à 2023, en tant que procureur général près la Cour de Cassation.
Benjamin MOREL : Maître de conférences en droit public à l'Université Paris II Panthéon-Assas, auteur d'une thèse remarquée sur le Sénat ainsi que d'articles savants sur les institutions parlementaires, les mouvements régionalistes et les collectivités territoriales, Benjamin Morel compte parmi les jeunes constitutionnalistes et politistes majeurs d’aujourd’hui, et l’un des observateurs les plus avisés de la vie politique française.
Il a publié au début de l’année 2023 « La France en miettes », livre qui se veut la dénonciation d’une indifférence à propos de l’ethno régionalisme, « idéologie dangereuse » à ses yeux, loin de renforcer la France dans sa diversité.
Servane MOUTONÂ : Servane Mouton est docteure en médecine, neurologue et neurophysiologiste, spécialisée en psychopathologie des apprentissages.
Elle s’intéresse particulièrement au neuro-développement normal et à ses troubles ainsi qu’aux liens entre santé et environnement, s’inscrivant dans la lignée des travaux de Michel Desmurget, auteur du best-seller « La fabrique du crétin digital ».
En avril 2023, elle coordonne ainsi le livre « Humanité et numérique, les liaisons dangereuses », réunissant une multitude d’experts ayant pour ambition d'informer sur les enjeux de santé, individuelle et collective, et sur l'impact environnemental lié à l'usage des nouvelles technologies, puis de discuter leur place dans le modèle économique actuel et dans la société, et de questionner le cadre juridique qui pourrait/devrait les réguler.
Véra NIKOLSKIÂ : Issue d'une famille de scientifiques, Véra Nikolski est normalienne, titulaire d'un DEA de sciences sociales et d'un doctorat en science politique.
Mère de trois filles et ancienne pratiquante d'arts martiaux, elle travaille désormais dans la fonction publique.
En 2023, elle publie « Féminicène », un essai dans lequel elle entend mettre en lumière « les vraies raisons de l'émancipation des femmes », ainsi que « les vrais dangers qui la menacent ».
Â
Hugues PERNET : En poste à Washington en 1990 et après avoir servi dans de multiples administrations, au sein de ministères ou auprès du Premier ministre Pierre Mauroy sur la question de la sécurité nucléaire en 1981 et 1982, le diplomate Hugues Pernet se voit confier la mission de créer de toute urgence la première représentation de la France en Ukraine, encore intégrée à l’Union soviétique.
En racontant son expérience de la chute de l'URSS telle qu'il l'a vécue, la permanence des enjeux géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie qui se cristallisaient déjà à l'époque et la vie quotidienne à Kiev en 1990, il permet de mieux comprendre la guerre actuelle, aux portes de l’Europe.
Pascal PERRI : Pascal Perri est journaliste et chef d'entreprise français dans l’agro-alimentaire ou le transport aérien.
Il a publié divers ouvrages sur les questions du transport, de l'énergie et de l'aménagement du territoire ou encore de football, et s’est également construit une carrière médiatique en participant, à partir de 2006, aux « Grandes Gueules » de RMC, programme dont il est l’une des figures phares mais qu’il quitte en 2018 pour animer sur LCI sa propre émission quotidienne de débat, « Perri Scope », consacrée à des thèmes d’actualité économique.

En septembre 2023, il publie « Génération farniente » dans lequel il entend décrypter le rapport défiant, sinon frondeur, de la société française au travail.
Pascal PERRINEAU : Visage familier du grand public pour ses apparitions régulières dans les médias, notamment sur le plateau de « C dans l’air » dont il est un invité régulier, Pascal Perrineau est l’un des politologues dont la voix fait autorité en France, spécialiste de sociologie électorale.
Il est directeur du CEVIPOF, le Centre de recherches politiques de Sciences Po Paris, de 1992 à 2013 et professeur des Universités à l’Institut d’études politiques de Paris où il a la charge de plusieurs cours portant sur le vote, l’analyse des comportements et des attitudes politiques, la science politique et l’extrême droite en France et en Europe.
En 2019, il fut l'un des cinq « garants » du grand débat national organisé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise résultant du mouvement des Gilets Jaunes.
Monique PINÇON-CHARLOT : Monique Pinçon-Charlot est l’une des figures majeures de la sociologie en France, longtemps directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'Institut de recherche sur les sociétés contemporaines (IRESCO) de l’université Paris-VIII, jusqu'à son départ à la retraite en 2007.
Durant toute sa carrière, elle a travaillé en collaboration principale avec son mari Michel Pinçon, également sociologue.
Ensemble, ils ont coécrit la majeure partie de leurs ouvrages qui traitent des classes supérieures de la société, en particulier de la grande bourgeoisie parisienne, à travers des concepts tels que la ségrégartion urbaine, l'homogamie ou encore la reproduction sociale. 
Ils ont notamment rédigé une « Sociologie de la bourgeoisie » en 2000, « Le Président des riches » consacré à Nicolas Sarkozy dix ans plus tard puis « Le Président des ultra-riches », décryptant ce qu’ils analysent comme le « mépris de classe » d’Emmanuel Macron en 2019.
En septembre 2023, Monique Pinçon-Charlot enfonce le clou en publiant « Le Méprisant de la République ».
Edwy PLENEL : Edwy Plenel est journaliste depuis 1976.
 D’abord à « Rouge » puis quelques mois au « Matin de Paris » mais, surtout, au « Monde » pendant 25 ans, de 1980 à 2005 dont il est rédacteur de la rédaction huit années durant.
D'abord spécialiste des questions d'éducation, il devient « rubricard police » et s'y fait remarquer par ses enquêtes.
Ses enquêtes sur la plupart des affaires de la présidence de François Mitterrand feront de lui une figure du journalisme d’investigation à la française, critique des différents pouvoirs.

C’est dans ce sillage qu’il cofonde et dirige depuis 2008 le site d’information « Médiapart » désormais incontournable, à l’origine de nombreuses révélations concernant aussi bien Jérôme Cahuzac que l’affaire Bettencourt, les « Football Leaks » et l’affaire Sarkozy-Kadhafi.

Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages parmi lesquels « Pour les Musulmans », « L’appel à la vigilance - Face à l’extrême-droite » ou le dernier en date, « Se tenir droit ».
Alain POLICAR : Politiste, agrégé de sciences sociales, Docteur en science politique (IEP de Paris), Alain Policar a accompli l’essentiel de sa carrière à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges. Il est actuellement chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences-Po (Cevipof), et auteur de nombreux ouvrages, notamment « Comment peut-on être cosmopolite ? » ou, plus récémment, « La haine de l’antiracisme » aux éditions Textuel.
Il intervient régulièrement dans la presse et est l’auteur de nombreuses tribunes, notamment dans « Libération », « Le Monde » ou « L’Humanité ».
Membre de l'Union rationaliste et du Comité de rédaction de « Raison présente », il a été nommé en avril 2023 par Pap Ndiaye au Conseil des sages de la laïcité et de l'intégration.
Philippe RISOLI : Comédien et chanteur, Philippe Risoli fut surtout l’un des animateurs les plus populaires des années 80 et 90, à l’époque de la toute-puissante télévision.
Passé par Canal + puis brièvement par France 3, c’est sur TF1, à la présentation de « Jeopardy! » pendant trois ans, d’« Intervilles » mais surtout du « Millionnaire » et du « Juste Prix », diffusé chaque midi pendant neuf ans à partir de 1992, qu’il devient l’un des visages familiers de la petite lucarne.
En retrait de la télévision après la suppression de cette dernière émission - qui ne survivra pas au passage à l’Euro - il est finalement évincé de TF1 et se consacre désormais au théâtre.

Il publie, en cette rentrée 2023, son autobiographie, longuement consacrée à la maladie et la disparition de son père, mais aussi à son parcours, les ambitions dévorantes et les désillusions en cascade que renferme le monde de la télévision et des écrans.
Â
Sandrine ROUSSEAU : Sandrine Rousseau est membre fondatrice d’Europe Écologie Les Verts et députée de la 9ème circonscription de Paris depuis juin 2022.
Elle se porte candidate à la primaire de l'écologie en vue de l'élection présidentielle de 2022 où elle est battue au second tour par Yannick Jadot. Au terme d'une campagne lors de laquelle elle émerge par des prises de position écoféministes alors marginales, elle s’impose comme une figure de premier plan du combat écologiste et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, devenant ainsi une actrice importante du débat public.
Volontiers clivante dans ses prises de position, assumant sa radicalité, chacune de ses interventions médiatiques est désormais scrutée, décryptée, commentée, suscitant aussi bien l’adhésion que le rejet.
Avant de s’imposer dans le paysage politique, elle est enseignante-chercheuse en sciences économiques, spécialisée dans l’économie de l’environnement, et vice-présidente de l’Université de Lille (2008-2021).
Emmanuel ROUX : Dans une première vie, entre 1994 et 2001, Emmanuel Roux, agrégé de philosophie, a été professeur en lycée à Niort puis à Briançon et en Avignon. Il décroche le concours de l’ENA en 2001.
Magistrat à la Cour des Comptes pendant six ans, il entre en 2011 à la Mutualité française où il dirige son travail de séminaire sur les relations entre l'assurance-maladie obligatoire et les complémentaires santé.
Au printemps 2023, il publie avec Mathias Roux « Le goût du crime - Enquête sur le pouvoir d'attraction des affaires criminelles » qui interroge les ressorts de notre intérêt pour les histoires, les énigmes et les enquêtes criminelles.
Ségolène ROYALÂ : Responsable politique de premier plan depuis plus de trente ans, Ségolène Royal adhère au Parti socialiste (PS) dès 1978.
Présidente du conseil régional de Poitou-Charentes de 2004 à 2014, députée des Deux-Sèvres de 2002 à 2007, ministre à plusieurs reprises (ministre déléguée à la Famille, à l’Enfance et aux Personnes handicapées de 2000 à 2002, ministre de l’Environnement de 1992 à 1993 puis de 2014 à 2017 ou encore ministre déléguée à l’Enseignement scolaire de 1997 à 2000), c’est en 2007 qu’elle explose véritablement aux yeux du grand public en étant propulsée candidate du Parti socialiste à l’élection présidentielle à l’issue de laquelle elle est battue de peu au second tour par Nicolas Sarkozy, après une campagne marquée par une atmosphère de sexisme ambiant jusque dans son propre parti.
Elle occupe le poste d’ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique de 2017 à 2020, après quoi elle annonce souhaiter conduire une liste unique de gauche aux élections européennes de 2024, se rapprochant ainsi de la NUPES.
Éric SADIN : Écrivain et philosophe, Éric Sadin est l'un des penseurs majeurs du monde numérique, développant une pensée ouvertement technocritique. Ainsi, il explore certaines des mutations décisives de la fin du XXème et du début du XXIème siècle en alternant ouvrages littéraires et théoriques.
En 1999, il fonde la revue « éc/artS », dédiée aux pratiques artistiques et aux nouvelles technologies.
Il commence à se faire connaître en publiant en 2009 son livre « Surveillance globale : enquête sur les nouvelles formes de contrôle ». Il devient par la suite un intervenant régulier à Sciences Po Paris, et intervient dans de nombreuses universités et centres de recherches en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Ses livres sont par ailleurs traduits dans plusieurs langues, parmi lesquels « La silicolonisation du monde » paru en 2016 ou « L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle, anatomie d’un antihumanisme radical ».
Jean-Louis SCHOELLKOPF : Photographe documentaire et artiste contemporain, Jean-Louis Schoellkopf est le régional de l’étape, son atelier étant installé dans les locaux de DMC.
Son travail explore les problèmes de la ville contemporaine, confrontée aux modifications dues aux nouvelles options économiques à l'Å“uvre, aux changements dans le monde de l'entreprise et de la production industrielle.
Tous ces changements idéologiques engendrent une redistribution des espaces urbains, définissent de nouvelles façons de concevoir et d'occuper la ville qui génèrent de nouveaux conflits. Dans ses différents projets, il s'attache à mettre en lumière ces enjeux, par la description et l'analyse de différentes situations urbaines, tant en France qu'en Europe, en tenant compte des points de vue historique, géographique et sociologique.
Que deviennent nos villes, nos usines, nos maisons ; comment les vivons-nous aujourd'hui ?
Nathalie SONNAC : Docteure en sciences économiques, spécialiste de l’économie des médias, de la culture et du numérique, Nathalie Sonnac s’intéresse en particulier aux questions de concurrence et de régulation, aux interactions entre les marchés médiatiques et publicitaires et leurs incidences sur la nature des contenus.
Elle cofonde et dirige en ce sens la Chaire d’enseignement et de recherche « Audiovisuel & Numérique » de l'université Panthéon-Assas.
En 2014, elle devient administratrice de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) puis est nommée par Claude Bartolone, alors Président de l’Assemblée Nationale, membre du Comité Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) en janvier 2015.

Elle est l’autrice de nombreux ouvrages sur ses questions de prédiléction parmi lesquels, publié au début de l’année 2023, « Le Nouveau monde des médias - Une urgence démocratique ».Â
Â
Julia STEINBERGER : Chercheuse suisse, britannique et américaine en économie écologique, Julia Steinberger est rofesseure à l’université de Leeds puis à celle de Lausanne, spécialisée dans les enjeux sociétaux liés aux impacts du dérèglement climatique.
Elle est coauteure principale du sixième rapport d’évaluation (2021-2023) du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), pour le troisième groupe de travail, contribuant à la discussion du rapport sur les voies d'atténuation du changement climatique.
Elle s’engage également dans la voie politique et militante, participant aux premières grèves du climat et aux actions de désobéissance civile non-violentes du mouvement Extinction Rebellion dès sa fondation au Royaume-Uni.
En octobre 2022, elle est ainsi arrêtée pendant quelques heures à la suite d'une action civile non violente de blocage d'une autoroute à Berne avec Renovate Switzerland.
Â
François SUREAU : Le 15 octobre 2020, François Sureau est élu à l’Académie Française au fauteuil de Max Gallo. 
L’aboutissement d’un parcours hors-norme l’ayant vu exceller tant comme haut fonctionnaire que comme avocat puis écrivain.
Après l’ENA, il devient auditeur au Conseil d’État avant de rejoindre le barreau de Paris en 1995 puis l'état-major du commandement de la Légion Étrangère et l’état-major des armées.
En juin 2014, il devient avocat auprès du Conseil d’État et de la Cour de cassation, poste qu’il quitte lors de son entrée à l’Académie Française en 2021.
Depuis une dizaine d’années, il s’engage en faveur des libertés publiques, contre l’état d’urgence et, plus généralement, contre des dispositions législatives qu'il considère comme répressives.
Ses principales plaidoiries au Conseil constitutionnel ont été publiées en 2017 sous le titre de « Pour la liberté », ouvrage suivi quelques mois plus tard du tract à succès « Sans la liberté ».

Il est par ailleurs l’auteur de nombreux romans parmi lesquels, récemment, « L’or du temps » ou « Un an dans la forêt » consacré à Blaise Cendars.
Gilbert THIEL : Juge d'instruction à Nancy, puis substitut général à la cour d'appel de Metz, où il instruit l'affaire Simone Weber, Gilbert Thiel est muté en 1994 à Paris, en qualité de Premier juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance (TGI).
Il mène notamment l'arrestation du tueur en série Guy Georges. En 1995, il est affecté à la section antiterroriste, où il instruit de nombreuses affaires, celle de l’affaire dite du « bagagiste de Roissy », Abderazak Besseghir, ou d’autres ayant trait au terrorisme corse.
Également homme de médias, Gilbert Thiel a tenu le rôle d'un président de tribunal de grande instance dans les saisons 4, 5, 6 et 7 de la série télévisée à succès « Engrenages ».Â
Jacques TOUBON : Proche de Jacques Chirac, Jacques Toubon suivra successivement le patron historique du RPR aux ministères des relations avec le Parlement, de l'Agriculture et de l'Intérieur, ainsi qu'à Matignon. À la faveur de ces fonctions, il prépare notamment la loi de 1975 sur le divorce par requête conjointe.
Élu député de Paris, il dirige la mairie du 13ème arrondissement de 1983 à 2001, succédant à Jack Lang au ministère de la Culture au sein du gouvernement Balladur en 1993. Il Å“uvre en particulier en faveur de la francophonie en portant la loi relative à l'emploi de la langue française, destinée à protéger le patrimoine linguistique français.
Il est ensuite nommé ministre de la Justice en 1995.
Jacques Toubon a par la suite été élu député européen de 2004 à 2009, puis a présidé de 2005 à 2014 le conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qu'il avait contribué à créer.
47 Degres Nord
En poursuivant la navigation sur le site, vous acceptez le dépôt de cookies et autres tags pour vous proposer des services et offres adaptés, des fonctions de partage vers les réseaux sociaux, permettre la personnalisation du contenu du site et analyser l’audience du site internet. Aucunes informations ne sera partagée avec des partenaires de 47 Degres Nord.